14 mai : Journée mondiale contre l'hypertension artérielle
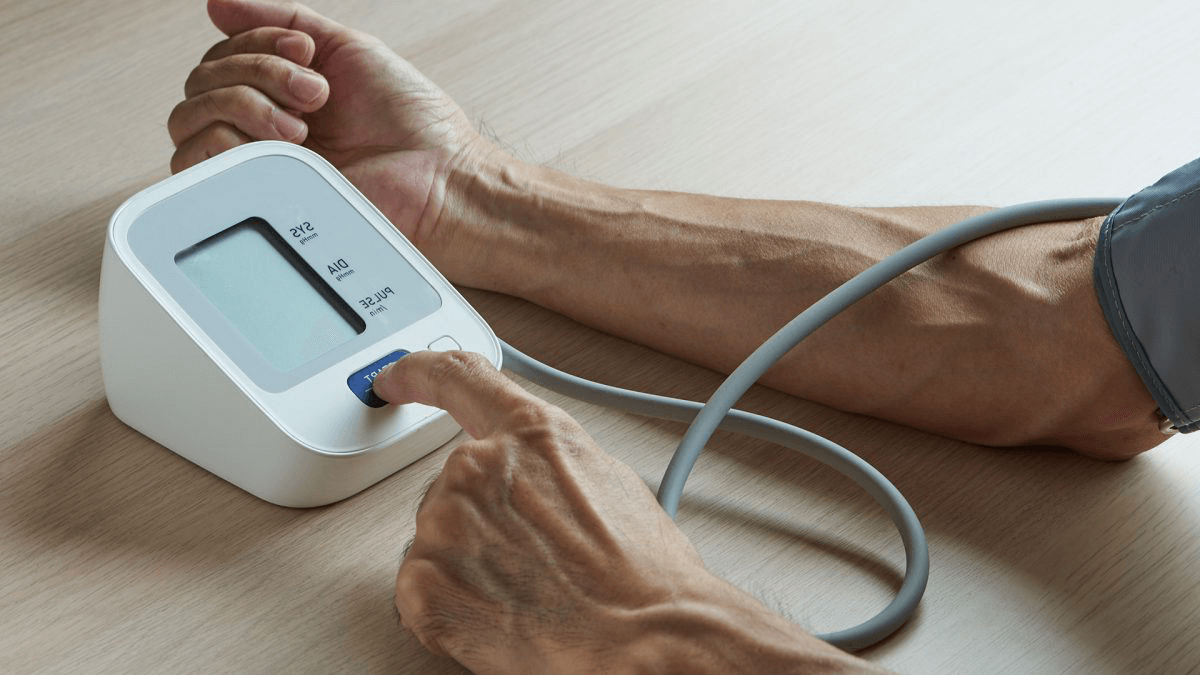
Manuel Van den Broucke, référent sport, société et politique, 14 mai 2025
Définition et causes de l’hypertension artérielle
L’hypertension artérielle (HTA) est une élévation persistante de la pression exercée par le sang sur la paroi des artères. La cause principale est la surcharge sodée : un apport de sel > 5 g/j accroît le volume plasmatique et stimule le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA), hormone régulant la tension. De plus, le surpoids et l’obésité augmentent le débit sanguin rénal, tandis que la sédentarité réduit la vasodilatation dépendante de l’oxyde nitrique - molécule qui garde les artères souples. La consommation excessive d’alcool (> 14 unités/sem), le tabagisme, le stress chronique et les carences en potassium aggravent encore la pression artérielle. Des médicaments courants, tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, la pilule estroprogestative, certains antidépresseurs ou les décongestifs contenant de la pseudo-éphédrine, peuvent aussi précipiter une HTA. Sur le plan génétique, plus de 30 loci ont été liés à la régulation de la pression, et un antécédent familial au premier degré double le risque d’HTA avant 55 ans.
Traitements disponibles
Lorsque les mesures hygiéno-diététiques (restriction sodée < 4 g/j, activité physique aérobie 150 min/sem, perte de 5 % du poids, arrêt du tabac) ne suffisent pas à atteindre la cible < 140/90 mmHg - ou < 130/80 mmHg chez le patient à haut risque - on initie une pharmacothérapie. Les cinq classes de médicaments sont : les diurétiques thiazidiques et apparentés, qui réduisent le volume extracellulaire ; les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC), qui bloquent la production d’angiotensine II ; les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II (ARA2), qui empêchent son action sur les récepteurs vasculaires ; les inhibiteurs calciques de type dihydropyridine, qui relâchent la musculature des artérioles ; et les bêtabloquants, qui freinent la stimulation adrénergique du cœur. Le choix thérapeutique repose sur le profil clinique : les IEC et ARA2 sont recommandés chez les patients diabétiques pour préserver la fonction rénale, les bêtabloquants sont indiqués après un infarctus du myocarde, et les inhibiteurs calciques sont utiles en cas d’angor vasospastique. Les diurétiques thiazidiques sont préférés chez les sujets âgés et en cas de surcharge hydrosodée, tandis que la spironolactone, un antagoniste de l’aldostérone, constitue une option efficace dans les formes résistantes, c’est-à-dire non contrôlées malgré trois médicaments bien conduits, dont un diurétique.